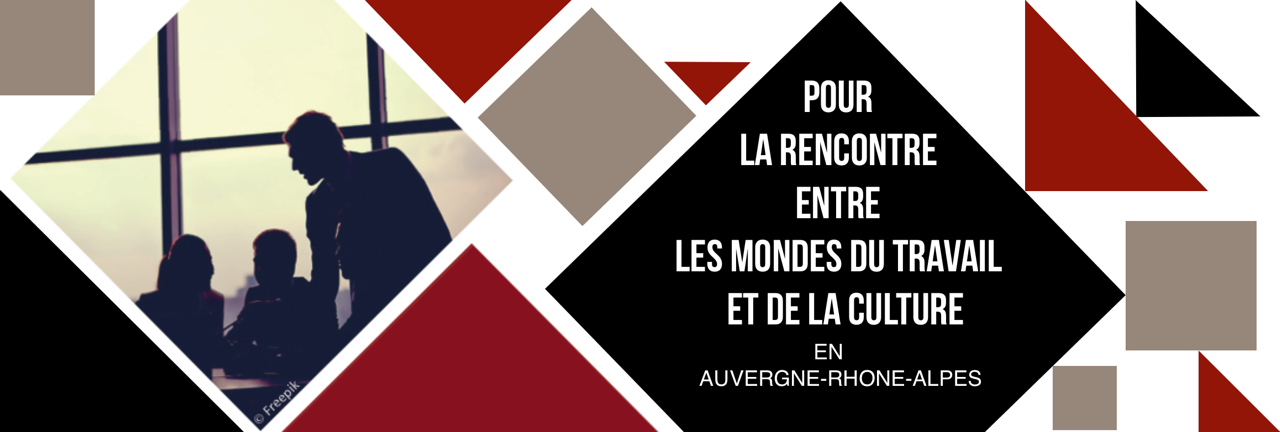LES DEUXIEMES RENCONTRES TRAC EN PREPARATION
Après avoir mis en place un site internet, et une lettre d’information, le TRAC veut reprendre son activité de partage d’information et de fonctionnement en réseau afin de promouvoir les initiatives artistiques et culturelles dans le monde du travail.
Comme nous l’avions annoncé en conclusion à la Bobine à Grenoble en février dernier, une nouvelle journée de rencontre était nécessaire pour finaliser nos réflexions et structurer le réseau TRAC.
Lors de sa dernière réunion au TNP de Villeurbanne début juillet, L’équipe d’animation TRAC a ainsi travaillé sur le contenu de cette deuxième journée. Nous vous présentons donc aujourd’hui les principaux axes de cette journée.
Cette deuxième rencontre est donc prévue pour le mois de novembre de cette année, cette fois à Lyon, le lieu étant encore à trouver.
DÉMARCHE COMMUNE
Afin de vous impliquer dans cette journée, et de véritablement fonctionner comme un réseau, nous vous communiquons le premier programme de cette journée pour le soumettre à votre avis. C’est pour s’adapter au mieux à vos besoins en terme de connaissances et d’outils, et pour suivre les recommandations de la journée du 13 février que nous adoptons cette démarche.
L’objectif de cette nouvelle journée est d’amener les participants à revenir sur les questions clefs, à s’interroger, et à mieux définir les enjeux et la nécessité de construire des ponts entre « Travail » et « Culture », afin de mieux envisager des axes possibles de réalisations concrètes.
AU PROGRAMME
Matinée
En atelier, sous la forme de world café en petits groupes, nous aborderons 3 questions clefs. Nous devons nous les ré-approprier afin de mieux partager les enjeux en terme de politique culturelle et de projets.
- Pourquoi réaliser des projets artistiques et culturels avec les salariés ? Dans les entreprises ? Sur le travail ?
- En quoi l’art et la culture sont un enjeu majeur pour la transformation sociale ?
- Sur quels critères construire une programmation culturelle ?
Nous solliciterons de grands témoins pour accompagner la réflexion collective et aider à la formalisation des idées.
Après-midi
Après avoir re précisé ensemble le cadre de notre réflexion, nous ouvrirons ensemble le chantier des actions possibles et souhaitables sous forme de groupes de travail. Plusieurs pistes seront proposées pour envisager de la façon la plus concrète possible des axes de travail commun. L’enjeu est bien de sortir de la journée avec des axes de travail commun.
- Quel cycle de formation? Plusieurs formations pourraient être envisagées, sur l’histoire de l’art, sur les CSE et les budgets, sur les manières de monter un projet culturel, et sur l’éducation populaire.
- En tant qu’artiste ou acteur culturel, comment rencontrer et travailler avec des CSE ? En général ces acteurs méconnaissent les CSE, leurs représentants, les financements, les chemins pour envisager des actions communes.
- Quels thèmes pour une programmation de conférence-débats, ou des ciné-débats?
- Comment créer un alter-salon? Les salons des CE sont devenus de vastes espaces commerciaux occupés par les grandes enseignes. La culture se résume en général à des stands de grands parcs de loisirs, alors que tellement d’alternatives existent….
- Comment utiliser le site internet de TRAC comme un outil de partage ? Le site pourrait devenir un outil d’information, de suggestion de spectacle et d’œuvres, de partage en terme de réflexion
Nous attendons vos retours sur cette journée afin de prendre en compte vos remarques, vos idées et vos besoins pour une meilleure coopération entre ces deux mondes.
L’équipe d’animation de TRAC